Montréal - Natashquan. Entre nature sauvage et Histoire...
Les Québécois aiment leur Belle Province et n’hésitent pas à parcourir de grandes distances pour mieux la connaître. Anne-Marie et Claude, Québécois pure laine, ont choisi d’aller au bout du bout... de la route, à la découverte de Natashquan, un petit village qui a vu naître Gilles Vigneault, poète et compositeur qui a marqué la culture québécoise récente. Ses prises de position en faveur d’un Québec indépendant et de la langue française, ont contribué - et pas qu’un peu - à rendre leur fierté et leur confiance à un peuple cerné de toute part. Anne-Marie a pris quelques notes et quelques photos qu’elle a légendé tout au long des étapes qui les ont conduit à atteindre leur objectif :
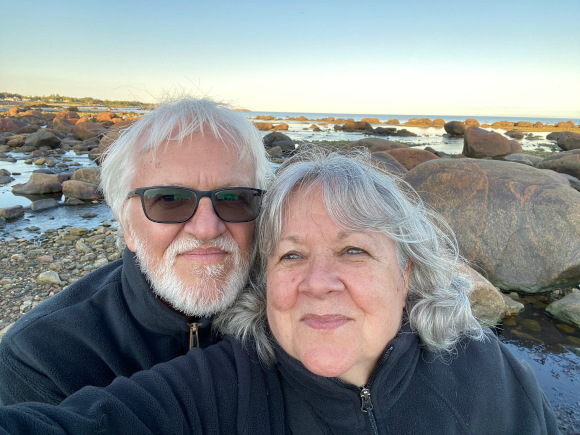
Depuis notre rencontre Claude et moi avons découvert les joies du camping et ses contraintes aussi. C’est une manière plaisante de voyager, à la rencontre de magnifiques paysages et de belles personnes. Une opportunité d’en apprendre un peu plus sur l’histoire locale.
Depuis 2022 nous songions à faire un voyage dans la région de la Côte Nord au Québec. Aucun de nous n’avait encore exploré ce coin de pays. Durant ce périple nous y avons découvert un territoire sauvage, grandiose et des gens qui prennent le temps de vivre. Évidemment, le rythme de vie n’est pas le même que celui que nous connaissons notamment dans les villes.
En ce beau mois d’août, nous voilà donc parti de Terrebonne à quelques kilomètres au Nord-Est de Montréal. Quinze étapes durant lesquelles nous avons parcouru 2 929 km. C’est relativement peu comparé à notre dernier voyage à Terre-Neuve long de 7 300 km… Nous nous sommes ainsi rendus jusqu’à Kégaska, non loin de Natashquan, notre destination d’origine. Il comporte une seule grande route. Elle longe le fleuve et le golfe Saint-Laurent.

- épinettes noires -

- forêt subarctique -
Première étape, La Malbaie. Pour y arriver, nous prenons la 138, « la route des Baleines » qui est devenue depuis quelques années une destination très touristique. Elle se situe sur la Côte Nord suivant le littoral du fleuve Saint-Laurent, de Tadoussac à Blanc-Sablon. Elle est précédée par « la Route du Fleuve », qui commence près de la ville de Québec. Le panorama qui se présente à nous est d’une grande beauté... sauvage. Nous roulons à travers une forêt enveloppante, parsemée de bouleaux et d’épinettes noires. À partir de Havre-Saint-Pierre, vers l’Est, nous constatons que les arbres deviennent plus petits. Il semblerait que le début de la forêt subarctique ne commence qu’à Baie-Comeau, juste avant, c’est la forêt boréale.

- Portneuf sur mer - -

- marais salés -
Il existe aussi sur la Côte Nord plusieurs réserves autochtones tel que Pessamit, Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Kawawachikamach et Essipit. Claude et moi avons fait un arrêt dans la réserve Pessamit où nous avons été très bien accueilli. Elle compte une population de 2428 habitants.
D’autres villages semblent par leur nom, être là pour nous rappeler l’importance de la religion dans l’Histoire de notre province. C’est en effet grâce au clergé catholique, omniprésent dès l’implantation des premiers colons venus de France, que le Québec a pu garder ses particularismes et surtout sa langue, le français. En 1867, une Loi constitutionnelle reconnaît l’usage des deux langues, le français et l’anglais, au Parlement et devant les tribunaux fédéraux. Il faudra attendre 1969 pour qu’elles soient déclarées langues officielles du Canada.
Nous avons donc traversé, à un moment ou à un autre : Saint-Paul du Nord, connu d’abord sous le nom de Baie-des-Mille-Vaches, 918 habitants ; Saint-Marc de Latour, 635 habitants ; Baie-Trinité, nommée par Jacques Cartier en 1536 en l’honneur de la Sainte Trinité, 438 habitants ; Rivière-Pentecôte, village fusionné avec Port-Cartier en 2003, 625 habitants ; Rivière-Saint-Jean, établi à la fin du 19e siècle, 227 habitants ; Havre-Saint-Pierre, anciennement nommé Pointe-aux-Esquimaux, 3330 habitants. Après la ville de Québec, capitale de la province, Baie-Comeau et Sept-Îles sont les deux seules villes d’importance, avec chacune environ 25 000 âmes.

- l'arboriduc de Forestville -
Parmi les nombreuses surprises de notre périple, l’arboriduc de Forestville se place en bonne position. C’est une grande structure en bois d’une longueur de 1,2 km qui servait à acheminer les billots de bois (localement appelés pitounes) de la rivière Sault-aux-cochons vers le quai de la compagnie papetière. Cette charpente remplie d’eau sous pression était installée en pente. Les billots flottaient sur l’eau jusqu’en bas de la côte avant d’être répartis dans des barges. Ce genre d’infrastructure n’existe plus au Québec. Celle-ci est l’unique qui existe encore, mais n’est plus fonctionnelle depuis 1992. Véritable « monument historique du patrimoine bâti », la ville de Forestville (2 900 habitants) l’a pieusement conservée. Pour visionner la vidéo qui date de 1980, cliquer ici.

Textes et photos © Anne-Marie Thomas
- à suivre : Toujours plus au Nord, toujours plus à l'Est...