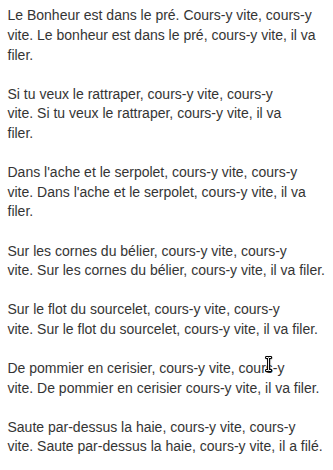Le bonheur est dans le pré… carré.
Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite.
Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite…. Il a filé.
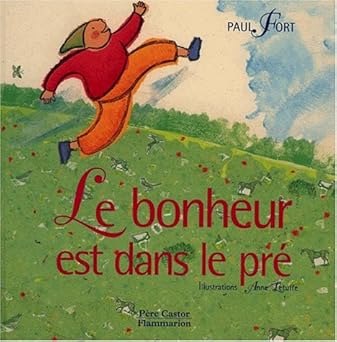
Comme seuls les poètes savent le dire, Paul Fort fait mouche. Jean-Marc Tennberg, diseur unique et regretté, donnait à cette poésie tout son sens et sa saveur. Le temps de pose qu’il marque dans le dernier « cours-y vite » et « il a filé » est délicieux, brillant, adorable. Il nous rend acteur complice de ce qui pourrait être qu’une simple comptine pour adulte consentant.
Dire que le bonheur est là, sous notre nez, que nous le voyons qu’au moment où il disparaît… serait n’est-ce pas, paraphraser le poète.
Pour le philosophe André Comte-Sponville, le bonheur peut se définir par l’absence de malheur… J’adhérerais volontiers à cette approche. Il ne faut peut-être pas en effet en demander trop et rêver d’un état de félicité permanent… On pourrait tout aussi bien appliquer le même traitement à la santé qui ne serait alors que l’absence de maladies. Nous en avons tous fait l’expérience, la santé, nous en prenons conscience seulement lorsque nous ne l’avons plus. D’où, d’ailleurs, la difficulté de mettre en place une médecine préventive…
La santé, le bonheur, nous avons tendance à prendre ces états aléatoires comme si ils allaient de soi, comme un dû. « Taking for granted » disent avec justesse les anglophones. Or, l’un et l’autre se méritent par des comportements et des choix, même si la chance - fruit du hasard - a son mot à dire. En effet, nul ne peut contrôler « l’Effet papillon ». Il y a une telle infinité de paramètres à prendre en compte que c’est impossible. Pourquoi avons-nous décidé l’autre matin de tourner à droite plutôt qu’à gauche ? Comment aurions-nous pu savoir qu’en prenant la gauche nous aurions été victime d’un accident mortel de la route ?
Pour Aristote : « Le bonheur consiste dans la vie heureuse, et la vie heureuse, c’est la vie vertueuse. » Une vie vertueuse, quésaco ? Une vie qui serait basée sur l’être et non le paraître, une vie où la générosité et le partage seraient notre quotidien. Une vie où l’on respecterait, à minima, les dix commandements. Objectifs ambitieux accessibles à très peu, totalement irréalisables pour la plupart d’entre nous.
J’aime bien aussi l’aphorisme minimaliste du dessinateur et écrivain Ylipe : La vie n’a que deux bouts ! Il est facile de deviner lesquels...
A l’automne de ma vie - disons même que l’hiver est déjà bien entamé - je ne suis pas devenu plus sage mais, l’accumulation d’expériences m’autorise à quelques réflexions sur le sujet. Et si le bonheur n’était que le résultat d’une construction intellectuelle, le fruit d’un conditionnement culturel ? Pourquoi sa recherche devrait être une fin en soi ? N’est-elle pas une illusion entretenue par les « romantiques » ? De tout temps, sur tous les continents, des hommes ont fait de « la recherche du bonheur » un sujet essentiel [un droit notamment inclus dans la déclaration d’indépendance des USA de 1776]. Les animaux, eux, n’ont pas ce soucis. Ce qui ne les empêche pas de souffrir, de faire des choix, de prendre du plaisir, de sourire, d’obéir comme nous à leurs pulsions…
Mon père Fernand avait coutume de dire : « il ne s’agit après tout, ici-bas, que de passer le temps. » Bien sûr, il y a 1000 façons de le faire. En gros, il y a les bonnes et les mauvaises façons. Question de critères personnels mâtinés de conditionnements sociétaux, culturels et religieux. Mais ça, c’est une autre histoire !