Littérature : les malheureux qui pleurent sur les bancs publics
Le temps n’est pas trop à l’apitoiement personnel et pourtant la littérature se met aussi à dépeindre les problèmes humains. Cependant loin de s’épancher sur les tragédies personnelles et de tomber dans le pathétique, certains auteurs français et internationaux abordent les drames ou petits tracas quotidiens sur un ton comique ou poétique.
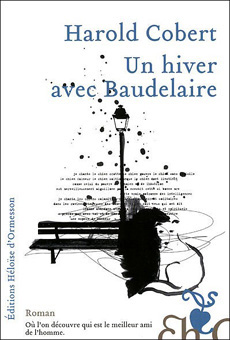
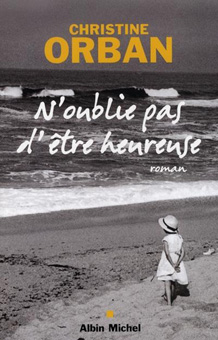
C’est le cas d’Harold Cobert qui, avec « Un hiver avec Baudelaire », après Francis Huster et Jean-Paul Belmondo, s’intéresse à « un homme et son chien ». Les circonstances sont bien plus graves car Philippe, personnage principal bien malchanceux, perd simultanément son travail et sa famille. Sans situation sociale et soutien sentimental, la société a tendance à, tout simplement, vous oublier ! C’est alors que les va-et-vient administratifs commencent pour le maussade nouvel homme de la rue. On se demande longtemps quelle est l’étrange origine du titre du livre. Harold Cobert, un peu comme un nouveau Baudelaire, a changé le spleen en désespoir omniprésent. Le chien auquel le poète du XIXème siècle donne son nom arrive très tard mais est un déclencheur positif pour le personnage principal. Alors que tous les hommes sont partis, les animaux demeurent car ils agissent sans mentir. L’homme est un loup pour l’homme et certainement pas un chien ! Pendant la crise où la peur de l’étranger et l’écrasement d’autrui croissent pour la survie personnelle, il est bon de se dire que « Nous ne méritons pas les chiens » selon le titre d’un roman de Gudule. Est-ce donc une si étrange idée de vouloir passer « Un hiver avec Baudelaire » en plein été aride ? Absolument pas, tellement la justesse du désespoir et la poésie prosodiée imprègnent le livre !
Face à ce fait social morose, Christine Orban passe de la sphère publique à celle du privé. Dans « N’oublie pas d’être heureuse », une petite fille se plaint, de façon un peu bourgeoise mais émouvante, de vivre dans une famille qu’elle trouve « à part ». Face à une mère assez envahissante et une tante fantasque, la fille grandit au Maroc en rêvant d’ailleurs. Aliénée par sa tante parisienne, cet « ailleurs » prendra vite les traits de Paris et la jeune fille idéalisera cette capitale et ses « snobs » qui la peuplent. Les utopies sont-elles trompeuses ? Une fois sur place, les désillusions sont, évidemment au rendez-vous. Le « Paris » qu’elle rencontre se révèle très snob, très stéréotypé et lointain de son rêve… et de sa terre natale. La jeune fille volontaire se rapproche en un sens de son rêve mais oublie parfois qui elle était. Son ami d’enfance est là pour lui rappeler mais jusqu’à quand ?
L’histoire peut être dévoilée car l’important n’est pas l’intrigue mais le recul de l’auteur sur sa vie ainsi que son style… enfin celui de Maria-Luisa, vrai miroir déformant de sa jeunesse. À la manière de Simone de Beauvoir, Christine Orban décrit la construction d’un être déraciné mais jamais à sa place dans le fantasme de sa vie. L’espoir est toujours présent malgré les échecs et les réalités acerbes de la capitale. Plus qu’une plainte nombriliste, le roman offre une vision critique et délectable des privilégiés parisiens, fort réjouissante !
Une référence plus cinématographique que littéraire viendra forcément à l’esprit de ceux qui se précipiteront sur le dernier ouvrage de David Sedaris : « Je suis très à cheval sur les principes ». On dit de lui que c’est le Woody Allen de la littérature. C’est faux ! Il est entouré de Woody Allen au féminin et les dépeint remplis de phobies. L’humour noir pour décrire la société occidentale n’est, en effet, pas sans rappeler le réalisateur New-Yorkais. Cependant, David Sedaris, humoriste, homme de radio et de lettres, ne se contente pas d’aborder un pan de la société mais diversifie son tir en traitant, à la manière d’un one-man show, bien des tracas d’un quadragénaire dans la société vieillissante. Et tout y passe : les maladresses insolites, le fait de vouloir passer pour une autochtone en voyage, les complexes physiques qui flirtent souvent avec l’auto-flagellation et ne perdent pas d’hilarité ! Oubliant parfois les problèmes sociaux, l’auteur narre toujours avec la même verve son histoire : de son Baby-sitting par une marâtre plus Folcoche que Mary Poppins à ses débuts dans l’écriture en passant par son indépendance atypique et son coming out. L’ensemble est bourré de clichés gigantesques mais l’auteur s’en rend lui-même compte. Et puis les clichés, n’est-ce pas ce qui fait le plus rire ?
L’humour ne fait pas tout, encore faut-il avoir la plume bien aiguisée ! L’auteur américain mise sur le décalage, la diversité mais aussi la maîtrise littéraire. Chaque récit pose un décor unique, neuf. Et l’on n’est même pas étonné de croiser une truculente voisine new-yorkaise aux faux airs de concierge dans les « Chroniques de San Francisco ! » Un hypocondriaque qui se respecte se doit de traiter à un moment ou à un autre de sa plus grande phobie : la mort. David Sedaris l’envisage de façon surprenante puisque c’est du point de vue légiste qu’il disserte sur ce funeste instant. L’américain aux multiples facettes s’arrêtera-t-il de nous étonner ? Pas sûr comme le laisse croire le chapitre final, véritable apothéose de ces nouvelles. Suite à un long questionnement personnel, l’auteur décide de cesser de fumer. Là où d’autres abuseraient de patch et chewing-gum à la nicotine, l’auteur privilégie le dépaysement et part faire sa cure anti-tabagisme au Japon. Le contraste entre les 2 cultures et l’apprentissage du japonais pour un occidental assez paresseux se révèlent être de purs moments de fous rires. Parfois, arrêter de fumer n’est pas qu’un art mais un sport et une philosophie de vie !
Le grand sourire que nous propose l’écrivain américain contraste avec les deux romans français plus mélancoliques. Les Français aiment-ils miser depuis Françoise Sagan sur ce « beau nom grave de tristesse » ?